 |
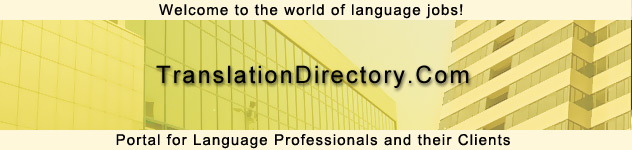 |
 |
| Home | More Articles | Join as a Member! | Post Your Job - Free! | All Translation Agencies |
|
|||||||
|
|
Culture et espéranto
Note de l'auteur. — Le texte du présent document incorpore toute une série de suggestions faites par MM. Claude GACOND, Roland GRANDIÈRE, Henri MASSON et Germain PIRLOT. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma très vive gratitude. 1. Complexité de la notion de
culture
Le terme «culture» exprime une notion complexe, recouvrant des éléments qui appartiennent au domaine des connaissances, à celui de la sensibilité, esthétique ou affective, et à celui de la mentalité. Il peut s'appliquer à une personne ou à une vaste collectivité. On dit d'un être humain qu'il est cultivé lorsqu'il a atteint un niveau suffisamment élevé dans les trois domaines. Si ce n'est pas le cas, on parlera d'érudit, d'expert, d'esthète, d'esprit ouvert, mais non de personne cultivée. Ces trois domaines se retrouvent également lorsque le terme «culture» est appliqué à une collectivité, qu'elle soit ethnique, nationale ou de quelque autre catégorie. Une culture, dans ce sens, représente un ensemble de connaissances et de conceptions, un certain type d'art et de sensibilité, une manière particulière d'aborder le réel ou de percevoir le monde, tous ces éléments conférant à un groupe humain une certaine spécificité. La réponse de Monsieur le Ministre semble supposer que langue, culture et civilisation se recoupent terme à terme. En fait, c'est loin d'être le cas. Il peut y avoir culture ou civilisation à des niveaux très différents. Si l'on parle si facilement de «civilisation occidentale» ou de «culture africaine», c'est bien parce que l'on pressent que ces concepts transcendent celui de la langue et peuvent s'appliquer à des collectivités bien plus vastes qu'un groupe linguistique. L'inverse est également vrai. Il est parfaitement légitime de considérer les civilisations britannique et américaine comme deux entités distinctes, même si elles s'expriment l'une et l'autre dans une langue pratiquement identique. On remarquera qu'il n'y a pas davantage coïncidence entre langue et peuple. Les peuples irlandais et américain ne se confondent ni entre eux, ni avec le peuple anglais, et un Suisse romand a beau partager la langue de Molière avec ses voisins français, il ne se sent pas — il n'est pas — membre du peuple français. L'appartenance à un même peuple implique une participation à une histoire, à des traditions, à un sentiment d'identité en grande partie indépendants de la communauté de langue. Notons enfin qu'on ne peut participer à une culture sans connaitre la ou les langues auxquelles elle est traditionnellement attachée. Bien des Chinois de Hong-Kong ou de Singapour sont de culture chinoise mais de langue anglaise, et ce qui distingue de ses compatriotes un Juif athée qui ne sait ni le yiddish, ni l'hébreu, ni aucune des autres langues parlées dans la diaspora juive (latino, tata, araméen...), c'est qu'il partage avec elle un ensemble de connaissances et d'habitudes intellectuelles, un certain type de sensibilité, une façon particulière de ressentir le monde : on peut être nourri de culture juive sans que la langue ou le pays y soit pour quoi que ce soit. Culture, pays, peuple et langue sont des réalités qui ne coïncident pas nécessairement. 2. Étude des langues : objectifs proclamés et réalité Monsieur le Ministre a parfaitement raison d'assigner deux objectifs possibles à l'étude d'une langue : accès à une culture et communication. Mais sa réponse, axée sur l'idéal, fait trop facilement fi de la réalité. Si le but de l'enseignement des langues est, pour l'Éducation nationale, l'accès à une culture, ce ne l'est ni pour les parents, ni pour les élèves. Ce que ceux-ci réclament, c'est un moyen de communiquer avec l'étranger, de s'élever dans l'échelle sociale ou d'améliorer leurs chances professionnelles. Certes, il est beau de tendre vers des objectifs élevés, mais, sous peine de donner dans l'utopie, il faut se poser la question de savoir s'il est réellement possible de les atteindre. Interrogez donc les jeunes qui ont fait au lycée six années d'anglais, d'allemand ou d'espagnol. Vous verrez que seul un infime pourcentage est à même de s'exprimer dans la langue étudiée. «Nous avons constaté qu'au niveau du baccalauréat, un enfant sur cent seulement parvient à s'exprimer correctement dans une langue étrangère. Quant à une deuxième langue, le résultat final aux plans de la culture et de l'élocution dépasse rarement le niveau du balbutiement», constate un pédagogue (1). Un niveau aussi élémentaire est-il comparable avec un accès authentique à la culture ? En outre, le lycéen moyen n'est pas particulièrement cultivé à l'égard de la civilisation à laquelle se rattache la langue choisie. Il suffit pour s'en rendre compte d'inviter quelques élèves d'anglais, pris au hasard, à parler de Shakespeare, de Tennyson ou de Graham Greene. Ils n'en savent pas plus que bien des personnes qui n'ont pas appris la langue, mais qui se sont intéressées à la littérature anglaise en recourant à des traductions. Bref, si l'on quitte les hautes sphères de l'utopie pour redescendre sur terre, on s'aperçoit que l'Éducation nationale n'est pas en mesure d'ouvrir, par l'enseignement scolaire des langues, l'accès à la capacité de communiquer convenablement, ni cet accès à la culture qu'a invoqué Monsieur le Ministre dans sa réponse précipitée. Quelle est la personne réellement cultivée ? Celle qui sait ou celle qui croit savoir ? Celle qui apprécie par elle-même ou celle qui répète ce que tout le monde dit ? Celle qui s'abstient de juger tant qu'elle n'a pas étudié la question ou celle qui tranche avant d'ouvrir le dossier ? La vraie culture est, heureusement, dument représentée au sein de la population. Mais elle est, par définition, modeste et se fait facilement vaincre, lors de la décision, par une rivale particulièrement puissante de nos jours : la pseudoculture. Celle-ci se caractérise par une aptitude à parler avec un ton d'autorité de sujets dont on ignore tout, mais sur lesquels on possède quelques idées glanées au hasard des magazines et des conversations de salon. Elle recherche moins la vérité que l'approbation générale et prend la modestie pour de l'insignifiance. Elle donne facilement dans la condescendance. Simplificatrice, elle prétend régler en un tournemain des questions très complexes, sans même se douter qu'il pourrait y avoir des faits à vérifier. Une bonne partie des jugements sur l'espéranto que l'on entend ou lit de nos jours relève de la pseudoculture. Peut-être Monsieur le Ministre et ses services n'ont-ils pas eu le temps de se documenter. Si c'est le cas, il est encore temps de le faire. Il est patent, en effet, qu'ils n'ont pas consulté la documentation disponible sur la valeur pédagogique de l'espéranto et sur la culture espérantophone ; qu'ils n'ont pas comparé les apports culturels réels que permettent l'étude de l'espéranto d'une part, celle des autres langues d'autre part ; qu'ils n'ont pas cherché à savoir si, à niveau d'instruction égal, les espérantophones étaient, dans l'ensemble, mieux familiarisés avec les cultures étrangères que leurs concitoyens ; qu'ils n'ont pas demandé un avis motivé aux professeurs d'espéranto des trois universités françaises où cette langue est enseignée (Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, Rennes) ; bref, qu'ils ont agi avec beaucoup de légèreté, pour ne pas dire avec un étonnant manque de respect envers les signataires des propositions de loi déposées au sujet de l'espéranto (2). Il serait intéressant de connaitre les publications qui ont aidé Monsieur le Ministre à orienter sa décision. Il est en effet hors de doute qu'elles sont loin d'être complètes et à jour, c'est-à-dire de correspondre au niveau actuel de l'interlinguistique et de l'espérantologie. En d'autres termes, c'est une réponse non fondée qu'a donnée Monsieur le Ministre. Il ferait preuve de sagesse s'il acceptait de la reconsidérer. 4. La culture espérantophone : réponses à quelques objections a priori Notons, tout d'abord que l'argument de Monsieur le Ministre, selon lequel l'espéranto serait une «langue créée pour les besoins de la seule communication» n'est pas recevable, et ce, pour trois raisons. Premièrement, il est manifeste que L. L. Zamenhof (l'initiateur de l'espéranto, ndlr) visait autre chose que la simple communication. La meilleure preuve en est que la petite brochure qui marque la première apparition publique de son projet contenait déjà un poème original (3) ; la poésie a d'ailleurs occupé une place de choix tout au long de l'élaboration qui a abouti à la «Langue Internationale» de 1887 (4). Deuxièmement, toute création tombant dans le domaine public subit une évolution qui l'éloigne parfois beaucoup de sa destination initiale. Edison ne se doutait pas, quand il a conçu l'enregistrement sonore, que son invention servirait un jour essentiellement au plaisir des mélomanes. Et lorsque Panini a créé la grammaire sanskrite, pour des besoins exclusivement liturgiques et théologiques, il ne s'attendait pas à voir son œuvre servir par la suite de langue littéraire à une vaste partie de l'Inde. Un argument qui ignore l'action de l'histoire est dépourvu de fondement. Troisièmement, L. L. Zamenhof n'a pas «créé» une langue. Il s'est borné à jeter les bases rationnelles d'un moyen d'expression linguistique qui ne s'est transformé en langue vivante que par l'usage. Ce serait une grave erreur de ramener l'espéranto tel qu'il se parle et s'écrit aujourd'hui au contenu de la petite brochure de 1887. Quoi qu'il en soit, si Monsieur le Ministre voulait bien lire le chapitre 5 — «La littérature » — du "Que Sais-je ?" consacré à la langue de Zamnehof (5), il découvrirait que l'espéranto donne bel et bien accès à une culture. Que cette culture soit souvent méconnue ne l'empêche pas d'exister. On ne supprime pas une réalité en l'ignorant. Cette culture a sa spécificité dans les trois domaines mentionnés ci-dessus : éléments cognitifs (6), sensibilité (7), mentalité (8), mais cette spécificité s'intègre harmonieusement aux autres appartenances ethniques et culturelles. De même qu'on peut être à la fois de culture alsacienne et de culture française, de culture britannique et de culture hindoue, de même on peut avoir une double identité culturelle, l'une nationale ou ethnique, l'autre dérivant de l'appartenance au monde de l'espéranto. Parfois causes de tensions psychologiques — et souvent à la suite de ces tensions —, ces doubles appartenances représentent en fait dans la plupart des cas un enrichissement pour la personnalité. La spécificité culturelle de l'espéranto représente-t-elle un handicap par rapport à sa vocation universelle ? L'exemple du latin médiéval et de la koïné grecque en Méditerranée orientale au début de notre ère montre qu'il n'en est rien. Une langue peut être, au départ, marquée par les caractéristiques d'une collectivité limitée et pourtant se prêter admirablement à la communication entre personnes de mentalités complètement différentes. L'espéranto présente moins de risques que les autres langues à cet égard, précisément parce que c'est une langue inter-peuples dès l'origine, au substrat totalement interculturel. Ceux qui estiment que la culture espérantophone n'est pas une vraie culture parce qu'elle n'est pas attachée à un pays oublient qu'il existe d'autres exemples de cultures de diaspora : la culture romanie (tzigane) et la culture yiddish, pour n'en citer que deux. Reprocher à l'espéranto sa jeunesse revient à démontrer que l'on connait mal l'histoire culturelle de l'humanité. L'espéranto existe depuis à peu près un siècle. Il existait déjà une culture chrétienne, avec sa mentalité, son type de sensibilité, son art propre — culture de diaspora, elle aussi — un siècle à peine après la naissance du christianisme ; cette culture était spécifique, bien différente de l'univers mental gréco-romain au milieu duquel elle vivait. Autre exemple : dès que Dante eut écrit la Divine Comédie dans la langue qu'il avait forgée, empruntant son lexique aux divers dialectes italiens, puisant largement dans les langues anciennes, choisissant arbitrairement telle ou telle autre forme grammaticale, il existait une œuvre culturelle digne d'être étudiée. Point n'était besoin d'attendre un siècle pour qu'on puisse parler de culture. Certains n'arrivent pas à croire à l'existence d'une culture propre à l'espéranto parce que, disent-ils, c'est une langue sans peuple. De nouveau, il s'agit d'une méconnaissance de l'histoire culturelle de notre planète. Il ne peut y avoir de culture, ou d'ailleurs de langue vivante, sans une collectivité attachée à cette culture ou à cette langue et animée du désir, conscient ou non, de la faire vivre. Mais «collectivité» ne signifie pas «peuple». La culture chrétienne des premiers siècles n'était pas liée à un peuple unique, très loin de là, elle était l'œuvre collective d'éléments très disparates de la partie la plus cosmopolite de l'Empire romain. La culture latine du Moyen-Âge et de la Renaissance était elle aussi polyethnique, comme l'était la culture sanskrite, comme l'est la culture swahilie. On l'a vu dans l'introduction : les notions de culture, de langue et de peuple ne se recoupent pas terme à terme. Quant à ceux qui dénient à l'espéranto toute valeur culturelle sous prétexte que ce serait «l'œuvre d'un seul homme», ils démontrent par là leur ignorance des faits historiques. La petite brochure de Zamenhof n'était qu'un point de départ et l'espéranto d'aujourd'hui est la résultante d'un foisonnement de communications qui couvrent la majeure partie du globe depuis quatre générations. Au demeurant, il n'y aurait rien d'anormal à ce qu'une langue littéraire naisse du talent linguistique d'un homme ou de l'impulsion d'un mouvement. Les langues littéraires italienne et russe n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu Dante et Lomonosov. Et le chinois littéraire d'aujourd'hui — plus jeune que l'espéranto (9) — est né d'un mouvement comparable à celui de la Pléiade. (Le chinois écrit jusqu'en 1919 était aussi différent du chinois écrit actuel que le latin l'était du français lors la constitution de notre langue écrite.) En fait, toute langue littéraire vivante implique un réseau complexe d'interactions entre créateurs-chercheurs (écrivains), créateurs spontanés (usagers, et notamment la partie de la population qui a le plus de verve) et codificateurs (grammairiens, enseignants), ces termes désignant des fonctions et non des personnes (une même personne peut passer de l'un de ces rôles à l'autre). Si l'on étudie l'histoire de l'espéranto, on s'aperçoit qu'il ne diffère pas des autres langues à cet égard : ce même jeu d'interactions y est à l'œuvre depuis le début. Il est piquant de constater que les défenseurs de l'espéranto doivent faire face aujourd'hui aux objections que réfutait déjà la Défense et Illustration de la langue française. Mais qui, de nos jours, se souvient de Du Bellay : «Les langues ne sont nées d'elles-mêmes en façon d'herbes, racines et arbres (...) mais toute leur vertu est née au monde du vouloir et arbitre des mortels» (10) ? Ou encore de Rabelais, parfaitement conscient lui aussi du caractère conventionnel et arbitraire du langage : «C'est erreur de dire que nous ayons langage naturel : les langues sont par institution arbitraire et convention des peuples» (11) ? 5. Une culture se juge sur pièces Les considérations qui précèdent n'ont été formulées ici que parce que Monsieur le Ministre s'exprime comme si l'inexistence d'une culture espérantophone allait de soi. En fait, il aurait sans doute été indiqué de refuser purement et simplement de s'attarder sur des objections a priori. Une culture se juge sur pièces. Dès lors qu'elle vit et que les documents sont là, disponibles à tout chercheur de bonne foi, elle ne devrait pas avoir à faire la preuve de son existence (12). Mais, dira-t-on, il ne suffit pas qu'une culture existe, encore faut-il qu'elle présente un intérêt justifiant l'inclusion de la langue correspondante parmi les matières à option. Il serait facile de démontrer que la littérature originale en espéranto est plus riche que la littérature bretonne et plus variée que la littérature néerlandaise, ou encore qu'il parait en espéranto plus de revues littéraires qu'en occitan, toutes langues dont nul ne conteste plus la valeur culturelle. Mais il vaut mieux laisser au lecteur le soin de juger par lui-même. S'il parcourt les 135 pages consacrées à la littérature de l'espéranto dans l'ouvrage de Lapenna, Lins et Carlevaro cité en annexe (avant-dernier titre de la note 12), il n'aura plus aucun doute à ce sujet. Peut-être voudra-t-il en outre méditer ces quelques lignes écrites par un professeur de littérature américaine au terme d'une étude de la littérature originale de la langue de Zamenhof : «Après une expérience de trois quarts de siècle étendue peu à peu à tous les pays, la preuve est faite qu'une langue artificielle peut exprimer toutes les richesses de l'âme lorsque, comme l'espéranto, elle a su créer et développer la sienne.» (13) C'est un fait : à l'instar d'autres cultures de diaspora — culture yiddish, culture chrétienne des premiers siècles —, la culture espérantophone est spécifique, elle a un esprit, un génie, une âme qui lui sont propres. Proportionnellement au nombre de locuteurs, elle est extrêmement productive et sa vitalité est remarquable, de même que sa qualité. Toutes sortes d'indices en témoignent. Citons par exemple cet éditeur d'œuvres littéraires qui remarquait naguère que le tirage d'un recueil de poèmes originaux en espéranto était actuellement supérieur à celui d'une publication comparable en français (14). Ou encore le fait suivant. Un auteur généralement considéré comme l'un des meilleurs romanciers chinois contemporains, Bajin (Bakin, Pa Kin), qui n'a pas honte de proclamer son appartenance au monde espérantophone et toute l'estime qu'il porte à sa culture, a lui-même expliqué dans la préface à son roman Automne au printemps qu'il avait tiré son inspiration d'une œuvre originale en espéranto, "Printemps en automne", du Hongrois J. Baghy (15). Entre tant de détracteurs de la langue internationale et l'un des chefs de file de la culture chinoise, n'est-il pas raisonnable de préférer l'avis le plus autorisé, c'est-à-dire l'opinion de celui qui a fait la preuve de son génie littéraire et qui, de surcroit, juge une culture qu'il connait, lui, personnellement ? Notons enfin que la vitalité et la spécificité de la culture espérantophone se traduisent également par l'originalité au niveau de la forme. Comment une langue pourrait-elle engendrer une forme poétique tout à fait originale (16) si elle se ramenait à une «simple transcription linguistique » ? 6. Avantages
culturels, pour les élèves, de l'étude
A. Originaux Il est bon qu'un pays offre aux jeunes qui vont entreprendre l'étude d'une langue étrangère la possibilité de choisir parmi une large gamme d'idiomes et l'on peut regretter de voir les lycéens tirer si peu parti de l'occasion qui leur est faite de se familiariser, par ce biais, avec quelques-unes des cultures les plus intéressantes du monde. Chacune des langues proposées aux élèves ne peut qu'inspirer un profond respect et il serait souhaitable que les choix des parents se répartissent de façon moins déséquilibrée. Il n'est pas question, ici, de demander une place privilégiée pour l'espéranto. Mais il faut être objectif. Si l'on étudie les avantages culturels qu'un élève retire de l'étude de l'espéranto d'une part, des autres langues d'autre part, force est de constater que la balance penche en faveur de la langue de Zamenhof, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un élève acquiert en une année scolaire une maitrise suffisante de la langue pour que les années suivantes soient exclusivement consacrées à la littérature et aux autres expressions de la culture (18/19/20/21/22). Cette remarque n'est applicable à aucune des langues que peuvent apprendre les élèves de l'enseignement secondaire. L'accès à la culture dont parle Monsieur le Ministre n'est actuellement, si l'on regarde la réalité en face, qu'une timide introduction. Ce n'est qu'au niveau de la Faculté de Lettres qu'un tout petit pourcentage de jeunes pénètrent réellement les cultures anglaise, allemande, espagnole ou autres. Dans le cas de l'espéranto, la situation est tout à fait différente. Un an à peine après en avoir amorcé l'étude, les élèves se trouvent déjà en mesure d'aborder la culture dont il est porteur. À ce stade, ils sont pratiquement au même niveau, par rapport à la littérature espérantophone, que le jeune Français par rapport à la littérature française. Mais ce n'est pas tout. L'univers auquel le jeune a immédiatement accès plonge ses racines dans des traditions culturelles d'une très grande variété. L'enrichissement de l'esprit qui résulte de sa découverte est d'une qualité difficilement imaginable pour qui n'en a pas fait l'expérience. En étudiant la littérature d'expression française, on peut pressentir l'âme flamande à travers Verhaeren et la sensibilité africaine à travers Senghor, mais ces exemples sont l'exception. En espéranto, ils sont la règle. Lire, par exemple, les poèmes de Kálmán Kalocsay et les romans de Sandor Szathmári, c'est découvrir la culture espérantophone, certes, mais aussi l'âme hongroise. À partir de sa deuxième année d'espéranto, l'enfant va entrer en contact avec toutes sortes de sensibilités : islandaise avec Baldur Ragnarsson, catalane avec Jaume Grau Casas, écossaise avec William Auld, brésilienne avec Geraldo Mattos, lettone avec Nikolai Kurzens, japonaise avec Miyamoto Masao... La palette est riche, et si l'on tient compte de son accessibilité presque immédiate, on voit que l'espéranto est mieux placé que toutes les autres langues offertes aux jeunes Français pour assurer un véritable accès à une culture. Certains lecteurs se demanderont peut-être comment on peut arriver à assimiler en une année seulement une langue dotée d'un réel pouvoir d'expression et d'évocation. Faute de connaitre l'espéranto — ou d'autres langues qui permettent une performance comparable, tel l'indonésien —, ils croient que «richesse» est synonyme de «complication». Mais un alphabet de 26 lettres permet des chefs-d'œuvre aussi remarquables qu'une écriture complexe comptant des dizaines de milliers d'idéogrammes, et les sept notes de la gamme suffisent à écrire des symphonies d'une puissance artistique indiscutée. L'explication du miracle réside essentiellement dans la richesse d'une combinatoire dépourvue de lacune. Une démonstration approfondie ne serait pas à sa place ici, mais un exemple suffira sans doute à permettre au lecteur d'entrevoir ce dont il s'agit. «Chant» et «musique» sont des notions très proches, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'exprimer des sentiments ou de produire de la beauté au moyen de sons. Pourtant, en français, un seul des deux concepts a le droit à un verbe, un seul à un adjectif. On dit chanter, mais il n'existe pas de verbe signifiant «jouer de la musique», et l'adjectif musical n'a pas son pendant dans le domaine du chant (choral existe bien, mais n'est pas applicable au chant individuel ; vocal se rapporte aux qualités de la voix, non, par exemple, à la justesse du chant). En espéranto, l'élève qui a appris les racines muzik- et kant- pourra, sans avoir à consulter un dictionnaire, les employer sous forme verbale en ajoutant un –i (muziki, «faire de la musique» ; kanti, «chanter») et sous forme adjective en ajoutant un –a (muzika, «musical» ; kanta, «qui appartient au domaine du chant», «considéré du point de vue du chant», «qui a les propriétés du chant»). Le même principe étant généralisé à la totalité de la langue, par ailleurs exempte d'irrégularités, on obtient une grande richesse — et une remarquable expressivité — sans devoir charger la mémoire. Lorsque la poétesse espérantophone tchécoslovaque Eli Urbanová parle de la dolce lula belo betula («la beauté doucement berceuse des bouleaux»), n'obtient-elle pas un effet esthétiquement très satisfaisant malgré la simplicité des moyens linguistiques utilisés ? B. Traductions Si la culture espérantophone originale est digne d'être étudiée, il n'en reste pas moins qu'une bonne partie de l'intérêt culturel de l'espéranto réside dans les traductions littéraires. «On n'entre pas réellement en contact avec une culture par le biais de la traduction», objectera-t-on peut-être. Cette remarque est démentie par les faits. Dans le cadre d'une seule et même culture, une traduction peut déjà être nécessaire pour certaines œuvres : la "Chanson de Roland" fait partie du patrimoine culturel français, mais elle n'est plus accessible à personne dans le texte original. En outre, à notre époque, on ne peut se dire cultivé si l'on n'a pas quelque idée de l'œuvre d'un Shakespeare, d'un Dante, d'un Gœthe ou d'un Dostoïevski. Est-ce à dire que le Français cultivé doit posséder l'anglais, l'italien, l'allemand et le russe ? Par ailleurs, dans certains cas, on n'accède à une culture donnée qu'en se familiarisant avec certaines traductions qui ont joué un rôle capital dans la constitution du patrimoine littéraire. On ne pénètre réellement la mentalité anglo-saxonne que si l'on connait la fameuse Authorized Version ('King James') de la Bible, qui fait partie — à côté, notamment, d'Alice aux pays des merveilles — du référentiel classique des peuples de langue anglaise. Du moment que l'on utilise des traductions, on a intérêt à recourir à celles qui se révèlent les plus fidèles, les plus précises, les mieux faites pour rendre l'esprit des textes originaux. Pour des raisons tenant à l'origine des traducteurs d'une part, aux structures linguistiques d'autre part, les versions en espéranto des œuvres littéraires sont bien supérieures aux traductions établies dans la plupart des autres langues. Origine
des traducteurs. Structures
linguistiques. En français, les feux rougeoient et les prairies verdoient, mais aucun verbe du même type n'existe pour les autres couleurs. L'espéranto, fondé sur le principe de la généralisation absolue de toute structure linguistique, ignore ce genre d'inhibition. Le traducteur qui doit rendre le mot russe černeet dit tout simplement nigras en espéranto, là où, traduisant en français, il serait bien embarassé : aucune des périphrases qu'il pourrait trouver — est noir, parait noir, donne une impression de noir, se détache en noir — n'est pleinement satisfaisante, aucune n'a le même pouvoir d'évocation que le verbe russe ou espéranto. On le voit, un traducteur motivé, percevant mieux que n'importe quel étranger les nuances, les connotations et les subtilités sémantiques de l'œuvre à traduire et disposant à cet effet d'un instrument particulièrement souple dont il a une véritable maitrise a toutes les chances d'aboutir à un résultat très réussi. Lorsque la traduction d'Eugène Onéguine en espéranto, par N. Nekrasov, est sortie de presse, un homme de lettres polonais, L. Belmont, a publié un article où il déclarait qu'elle était la plus belle et la plus fidèle (notamment par le respect du rythme) de toutes les versions étrangères qu'il avait étudiées (25). L. Belmont était bien placé pour juger, puisqu'il possédait parfaitement l'espéranto et qu'il était lui-même l'auteur d'une traduction polonaise de la célèbre œuvre de Pouchkine, traduction dont tous les critiques s'accordent à reconnaitre la très haute qualité. (Entre parenthèses, c'est à partir de cette version en espéranto, et non de l'original, qu'a été établie la version chinoise d'Eugène Onéguine ; le rôle de «langue-pont» joué par l'espéranto pour la traduction littéraire, surtout entre langues de faible diffusion, est l'un des traits particulièrement intéressants de son histoire.) Mais il serait fastidieux de s'étendre davantage sur ces questions. La démonstration a été faite ailleurs, et bien faite. Le lecteur intéressé pourra juger par lui-même en se reportant à ces travaux (26/27/28/29/30). Tous ceux qui ont enseigné l'espéranto aux enfants ont constaté qu'il stimulait la créativité. Or, le développement de l'imagination créatrice est essentiel à la vie de toute culture, tout comme il est indispensable à la santé mentale et à la prospérité d'une société, puisque l'art de résoudre les problèmes est dans une large mesure affaire d'imagination. L'utilisation de l'espéranto représente souvent un exercice des facultés créatrices parce que les structures de la langue portent l'usager à forger lui-même les expressions dont il a besoin. Pourvu qu'il respecte les exigences de la rigueur, elle aussi inhérente à l'espéranto, celui qui «invente» un vocable nouveau à partir des ressources de la langue sera immédiatement compris de tous ceux qui l'ont apprise. Outre ses incontestables avantages psychologiques, ce double exercice de la rigueur et de la fantaisie créatrice fait de l'accès à la culture espérantophone une aventure active, et non la découverte purement passive qu'est généralement l'approche d'une culture étrangère. Ces questions ont été traitées ailleurs (31) et une présentation détaillée sortirait du cadre du présent exposé. Rappelons simplement que tout enfant d'âge préscolaire manifeste une remarquable créativité linguistique : il ne cesse d'inventer des mots et des expressions. Il dira orangir pour dire «devenir orange», se démarier pour «divorcer», la jouetterie pour «le magasin de jouets». Chaque parent a pu relever de tels mots, généralement d'une parfaite cohérence, engendrés par le jeu spontané des facultés linguistiques de l'enfant. Cette fantaisie s'inhibe lorsque l'enfant acquiert la notion de langage correct, et on ne mesure peut-être pas assez le prix culturel et psychologique que paie une société lorsqu'elle impose ainsi ses normes linguistiques en associant à la notion de faute de langue des sentiments de ridicule ou de culpabilité. Au niveau de la langue maternelle, on n'a pas le choix : le maniement correct du langage est important pour l'avenir de l'enfant et il faut bien lui apprendre à réprimer sa créativité langagière et son gout pour la logique grammaticale. Un des intérêts psychologiques de l'espéranto est de les lui faire redécouvrir. En effet, le génie de la langue de Zamenhof tient en grande partie à l'intégration de deux principes fondamentaux : possibilité de combiner librement, à l'infini, des monèmes totalement invariables (trait que l'espéranto partage avec les langues dites «isolantes», comme le chinois), nécessité absolue de marquer la fonction du mot dans la phrase (trait qu'on retrouve dans la plupart des langues dites «agglutinantes», comme le turc). Le premier principe correspond au pôle «liberté», le second au pôle «rigueur» de toute création réussie. L'élève d'espéranto ne tarde pas à découvrir toutes les possibilités poétiques, humoristiques et autres d'une langue où, dès qu'on l'aborde en créateur, on se sent la liberté d'un Homère ou d'un Rabelais. Le petit Africain qui forme le mot kaprejo pour désigner l'enclos réservé aux chèvres, que l'on trouve dans chaque village de son pays, forge un mot correct, inclus dans le potentiel de la langue même s'il n'a d'équivalent exact que dans les langues africaines et si aucun auteur ne l'a utilisé avant lui. D'un bout à l'autre de la diaspora, tout espérantophone en comprendra immédiatement le sens. Et ne sont-ils pas créateurs, ces élèves qui «inventent» des expressions comme fotinda, «qui mériterait d'être photographié», ou Kial vi onklas al mi ?, «Pourquoi vous comportez-vous envers moi comme un oncle envers un neveu ?» (le verbe onkli — ici au présent onklas — est, par rapport au concept «oncle», ce que le terme psychanalytique materner est, en français, par rapport au concept «mère») ? La maitrise d'anglais implique une étude spécialisée et appronfondie de la langue de Shakespeare, réservée à un très petit pourcentage de la population. Elle représente un investissement considérable en temps, en argent, en énergie nerveuse. Pourtant, combien sont ceux qui, au terme de cet effort, osent publier un article en anglais sans se faire relire par un Anglo-Saxon ? Quels sont ceux qui oseraient rédiger en anglais un poème, une chanson, une nouvelle ? L'accès à la culture est purement passif dans le cas de l'anglais, comme il l'est pour les autres langues admises au baccalauréat, à l'exception, peut-être, des langues régionales (et ceci est un argument très fort en faveur du maintien de ces dernières dans l'enseignement). Dans le cas de l'espéranto, à cause des structures de la langue, l'élève accède dès la première année d'étude au stade de la créativité. Il redécouvre ainsi une fantaisie, souvent poétique, qu'il avait perdue vers l'âge de huit ans, mais il l'associe, heureusement, à la rigueur que supposent toute communication digne de ce nom, tout dégagement à l'égard de l'égocentrisme enfantin. En s'exerçant à la création littéraire en espéranto, l'élève affine deux autres qualités indispensables à tout accès authentique à une culture : le sens esthétique et le sens des nuances. Il est malheureusement impossible d'étayer ici cette affirmation. Le lecteur intéressé voudra bien se reporter à l'article précité (31). L'argumentation de Monsieur le Ministre ne résiste pas à l'étude des faits. Si le but de l'enseignement des langues est l'accès à une culture, comment expliquer la très grande prédominance de l'anglais par rapport aux langues enseignées (80 % des élèves «choisissent» l'anglais, 16 % l'allemand, 3 % l'espagnol et moins de 1 % une des autres langues) ? La culture anglo-saxonne présente-t-elle un intérêt supérieur aux autres langues dans une telle proportion ? Soyons honnêtes. Il n'y a pas parallélisme entre la place respective des cultures dans la civilisation humaine et leur place, en France, dans l'enseignement des langues. Mais, dira-t-on, il s'agit moins de donner à l'élève un bagage culturel que de le familiariser avec les mentalités étrangères ou le mode de vie de nos voisins. L'anomalie de la situation actuelle est tout aussi flagrante si l'on retient ce critère. Pourquoi l'anglais distance-t-il dans une telle mesure les langues des autres pays avec lesquels la France est en relations ? La vérité est que si l'anglais est si souvent enseigné, c'est parce que les parents le demandent. Et les parents ne le demandent pas par attachement à la culture anglo-saxonne. Ils le demandent parce qu'ils veulent doter leurs enfants d'un moyen de réussir dans la vie et que l'anglais leur parait augmenter les chances d'atteindre ce but. La situation de cette langue dans l'enseignement reflète une situation de pouvoir dans le monde, pouvoir des multinationales peut-être bien plus que des États. La culture n'a rien à voir là-dedans. Mais si l'intérêt pour la culture n'a rien à voir avec la situation actuelle de l'enseignement des langues, l'argument opposé à l'introduction de l'espéranto tombe automatiquement : la majeure du syllogisme est infirmée et la conclusion perd donc toute validité ; c'est par erreur, faute d'avoir perçu la situation dans sa réalité profonde, que Monsieur le Ministre a répondu négativement à la question qui lui était posée. Cela dit, il est intéressant de constater que même s'il était réaliste d'assigner comme objectif à l'enseignement des langues l'accès à une culture, la candidature de l'espéranto ne serait pas pour autant à rejeter d'office. La mineure du syllogisme est, elle aussi, infirmée par les faits. Les publications mentionnées dans les références bibliographiques le démontrent abondamment. Si Monsieur le Ministre n'est pas convaincu, il faut espérer qu'il aura à cœur de défendre sa position en faisant les recherches nécessaires pour réfuter point par point l'argumentation développée dans le présent document. Il s'apercevra qu'il n'existe pas un seul auteur qui, ayant étudié la question, conclue à l'inexistence ou à la superficialité de la culture espérantophone. L'attitude de Monsieur le Ministre est d'autant plus étonnante qu'elle se manifeste au sein d'un gouvernement socialiste. Faute de voir en face les causes profondes de la préférence des parents pour l'anglais et ce qu'implique réellement, pour l'élève moyen, l'accès à une culture, Monsieur le Ministre risque de favoriser une grave injustice sociale, et ce, à deux niveaux. Au niveau mondial tout d'abord, puisque sa position implique une reconnaissance de facto de la suprématie de l'anglais dans le monde. Ne manque-t-elle pas singulièrement de dignité, cette soumission à une culture qui n'a pas plus de titre qu'une autre à l'hégémonie, quels que soient sa réelle grandeur et son intérêt incontestable en tant que culture particulière ? (Qu'on comprenne bien le sens de cette remarque : il ne s'agit nullement de dénigrer la culture anglo-saxonne en tant que telle, elle a le droit au même respect que les cultures française, allemande, arabe ou japonaise, pour n'en citer que quelques-unes parmi l'étonnant foisonnement qu'ont produit les talents créateurs du genre humain. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'elle n'est qu'une culture parmi d'autres et qu'il serait sain pour tout le monde, notamment pour les peuples anglo-saxons et pour le maintien de la qualité de leur idiome, d'envisager l'adoption de mesures propres à la remettre à sa juste place.) Injustice au niveau de la population ensuite. Les langues actuellement enseignées dans les lycées sont trop difficiles pour être réellement maitrisées au terme des études secondaires. Cela signifie que ceux qui les possèderont à l'âge adulte auront bénéficié de deux conditions : être suffisamment doués et avoir fait au moins un séjour prolongé dans un pays étranger. En pratique, cette dernière condition revient à donner un avantage considérable aux familles suffisamment aisées pour pouvoir financer les séjours de leurs enfants dans les pays anglo-saxons. Est-ce socialement admissible ? Quant aux jeunes peu doués pour les langues ou trop peu motivés pour les apprendre — ils sont nombreux parmi les élèves attirés par les sciences et les mathématiques —, on les oblige à consacrer un pourcentage important de leurs activités scolaires à tenter d'assimiler des lexiques rébarbatifs et toutes sortes de règles compliquées sans le moindre profit pratique ou culturel. L'expérience a prouvé que ceux-là, en particulier, tirent de l'étude de l'espéranto de sérieux bénéfices, tant sur le plan de la culture que sur celui de l'épanouissement psychologique. Enfin, on peut regretter de voir un ministre traitant des langues minimiser à ce point l'importance de la communication. Ignore-t-il que la communication linguistique est dans un corps social l'équivalent de la conduction nerveuse dans un corps physique ? Que d'erreurs, que de délais, que d'absurdes gaspillages dus aux défauts et discriminations qui caractérisent la communication internationale telle qu'elle est actuellement organisée (32/33/34/35/36/37). De tels problèmes doivent être abordés de front, avec courage et lucidité, et déboucher sur un résultat concret. L'espéranto fait partie des options possibles et il n'y a aucune raison de refuser a priori d'étudier la solution qu'il offre aux problèmes de la communication linguistique (38). Son introduction dans l'enseignement aurait pour effet de faire prendre conscience aux élèves, de manière concrète, des problèmes sémantiques et autres que soulève la communication inter-peuples à l'échelle mondiale. Une conscience réelle de ces problèmes n'est-elle pas un élément important de la culture humaine à une époque où les moyens techniques facilitent les contacts avec les pays les plus lointains ? Il aurait été particulièrement opportun de la favoriser en 1983, Année mondiale des Communications. ____________
E-mail this article to your colleague! Need more translation jobs? Click here! Translation agencies are welcome to register here - Free! Freelance translators are welcome to register here - Free! |
|
|
Legal Disclaimer Site Map |